Liste des commentaires

|
Un frère
Danièle M le Mercredi 03-12-2025
Livre entre témoignage, introspection, journal intime, essai sur la maladie mentale de l’un de ses frères. Le narrateur s’y implique en -je- narrateur, refusant dignement l’anonymat. L’introduction est un moment crucial et irrémédiable : Édouard, le plus fragile de la fratrie de quatre enfants, vient de décéder brusquement, « sans prévenir ».
C’est l’élément déclencheur d’une confession et un motif d’écrire. Car en effet, David Thomas s’exerce à l’écriture avec hésitation, défaitisme mais obstination aussi.
Histoire d’une famille, pudeur, sentiments inavoués, moments de bonheur qui succèdent à l’incompréhension de ce glissement progressif de quarante ans d’Édouard, vers un néant déchirant pour tous.
Tous les moments d’une vie qui s’annonçait brillante par les études, les premières activités, l’intelligence jusqu’à parfois l’impertinence voire l’inconvenance de l’enfance, dans un environnement privilégié et une famille aimante, vont revenir à l’esprit de David dans un désordre pulsionnel. Et c’est peut-être ce que l’on pourrait reprocher à l’écrivain, car accablé par la douleur, et la culpabilité de ne s’être pas préoccupé de son frère les trois derniers jours, d’avoir accepté le silence, il va se laisser envahir par la puissance de l’affectif et exprimer parfois de façon récurrente les images qui l’assaillent.
La schizophrénie se déroule sous toutes ses formes, ses excès, ses instants de lucidité et de résilience mais elle grossit tel un monstre qui dévore l’esprit, malgré les traitements, les hospitalisations, les aménagements et sans doute aussi la difficulté pour se battre à armes égales. Surtout si les addictions comme l’alcool et la drogue qui aident à « oublier » s’amplifient, jusqu’à la démesure et donc le désir de mort.
Et le lecteur mesure alors combien la guérison est rendue incontrôlable par ces substances psychoactives qui, sous le leurre de procurer du plaisir, détruisent le système cérébral. Mais également le désarroi de l’entourage malgré toute sa bienveillance et son amour. Et la détresse est double pour celui qui reste : tragédie d’avoir perdu un autre soi-même et culpabilisation éternelle de n’avoir pas su ou pu enrailler ce processus.
|

|
La Magie du bonheur
Martine C le Samedi 15-11-2025
Ce magnifique roman est une histoire touchante sur la résilience, le deuil et la recherche du bonheur, jouant avec les limites entre le réel et l’imaginaire.
|
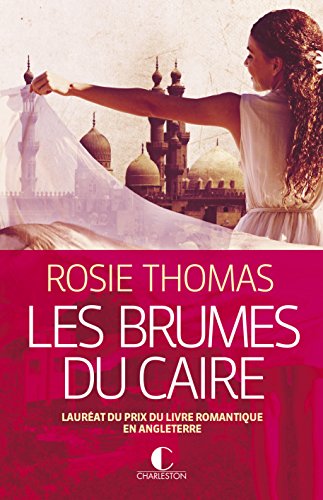
|
Les brumes du Caire
Martine C le Lundi 24-11-2025
Ce roman entremêle deux époques et explore un secret de famille. Ce livre est une exploration de l’amour, de la perte d’un vieil amour, de l’influence que cela a dans une vie et du poids du passé sur les générations.
|
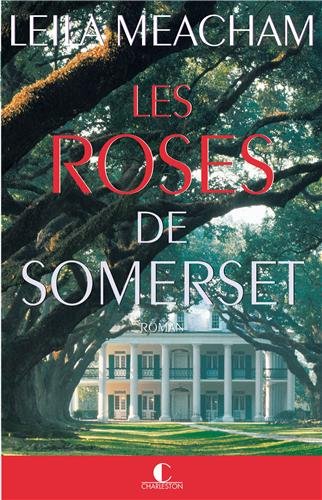
|
Les Roses de Somerset
Martine C le Lundi 01-12-2025
Ce roman est une vaste saga historique se déroulant au Texas mêlant histoire d’amour, orgueil familial et attachement à la terre, il est rempli de trahisons, de secrets, de rivalités, de drames.
|

|
Parfums
Danièle M le Lundi 27-10-2025
Étrange livre soigneusement découpé en 63 chapitres de 2 à 3 pages, exhalant chacun une odeur différente, car la thématique est bien les parfums.
Philippe Claudel n’a pas la primauté pour les évoquer, d’autres écrivains célèbres ont marqué leur sensibilité au sens de l’odorat : Colette, Giono, Hugo, Baudelaire, l’horrible J-B. Grenouille de Süskind qui rêvait de dominer le monde grâce à son seul odorat et, bien sûr, la mythique madeleine de Proust. D’autres encore, étrangers ou français, Cendrars, Baricco etc. ont écrit, inspirés par leurs sens développés, l’ouïe, le goût, le toucher ou la vue souvent, faisant appel à leurs souvenirs pour séduire le lecteur et le plonger lui aussi dans un passé plus ou moins proche par une sorte d’écho émotionnel et affectif.
Mais Claudel a évité ici toute fiction romancée pour écrire une sorte d’abécédaire personnel des fragrances de -a- à -v-, non sans poésie et émotion, toujours dans une langue économe, structurée, délaissant plutôt le -je- narrateur pour le -on- comme dans une implication universelle, un peu comme un dictionnaire mais surtout pas pour les Nuls !
Il passe en revue des lieux : coiffeur, gymnase, torréfaction, des personnes : amoureuses, salle de classe, des objets : alambic, cigare, savon.
Ainsi, au-delà du nez, le cerveau ou le cœur de chacun voit subrepticement se former une image plus ou moins agréable ou enfouie et, par un effet magique puisque inexplicable (on ne connait pas l’auteur), on revisite sa propre vie.
|

|
Des palmiers dans la neige
Martine C le Lundi 24-11-2025
Ce roman est une grande fresque romanesque et historique, basée sur une double temporalité, qui explore l’histoire coloniale espagnole en Guinée équatoriale. C’est un récit riche mélangeant l’aventure, la romance et une profonde réflexion sur l’héritage colonial et la force de l’amour face aux barrières sociales.
|

|
Le chant des oubliées
Martine C le Vendredi 07-11-2025
Roman poignant et intense qui rend un hommage vibrant aux femmes américaines, ces héroïnes inconnues, notamment aux infirmières ayant servi pendant la guerre du Vietnam et dont le rôle fût minimisé et longtemps ignoré, nous plongeant au cœur de la guerre et de ses conséquences durables.
|

|
Les Temps glorieux
Martine C le Mardi 21-10-2025
Cette saga est une histoire de famille, de secrets et de destins dramatiques. Ce premier tome nous dévoile l’histoire de la famille von Dranitz et de son domaine familial, et plus particulièrement celle de Franziska et de sa descendance des années 1930 à 1991, nous plongeant en Allemagne de l’Est dans les tourmentes du XXème siècle, des années de bonheur d’avant-guerre aux années post-réunification.
|

|
La Femme qui ne vieillissait pas
Danièle M le Lundi 03-11-2025
Histoire doublement inattendue. D’une part parce que Delacourt n’a pas habitué le lecteur à cette situation particulière d’une femme qui scrute sa vie, d’autre part parce que le -je- narrateur est bien Martine, alias Betty. La famille, sa propre famille principalement, est un thème rituellement évoqué et pour des raisons douloureuses. Ici le point de vue surprend d’autant plus que la famille Delattre semble, au-delà des circonstances qui la caractérisent, respirer la sérénité, la confiance, le bonheur en somme.
Mais Delacourt prend le contre-pied du cours de la vie : son héroïne ne vieillit pas. Rien en commun avec « La voyageuse de nuit » de Laure Adler !
Nous savons tous que l’âge qui passe ne marque pas l’homme et la femme de façon équitable et qu’avec la doctrine exacerbée actuelle du jeunisme, celle-ci n’est plus regardée, n’est plus acceptée dans certaines professions, certains rôles. (« Vieillir c’est voir se réduire notre place sur la terre, se rabougrir nos ombres » p. 120) Les chercheurs en cosmétologie et les chirurgiens plastiques s’en délectent d’ailleurs !
Comment ce passage des ans se vérifie-t-il ? Un ami photographe, Fabrice la prend au rythme de 33 photos toujours dans la même attitude, jusqu’à ses 63 ans et alors que sa meilleure amie Odette doit recourir à des artifices, le temps semble ignorer Betty.
Pourquoi ? Peut-être parce que le souvenir idéalisée d’une mère très belle, décédée alors qu’elle avait 13 ans, sublime toute son existence, ou simplement parce que la vie avec André son époux ébéniste-designer, son fils Sébastien, son emploi à la Redoute, la satisfait.
Le récit serait presque un long fleuve tranquille, si un grain de sable ne s’immisçait pas, mais l’on pose ce livre apaisé face à des évidences, à une philosophie de vie simple, admise, sans animosité. Et avec l’idée que cette recherche à tout prix d’une apparence parfaite est parfois aussi contreproductive. C’est là peut-être une clé du bonheur, du moins pour Betty.
L’être ou le paraître, that’s the eternal question !
Le lecteur avide de sensations fortes, d’ambitions jamais satisfaites, de polémiques ombrageuses doit impérativement choisir un autre livre !
|

|
Constance
Martine C le Lundi 27-10-2025
Ce roman explore l’amertume de la trahison et le poids du mensonge du passé. Deux sœurs doivent apprendre à se pardonner et à retrouver les liens de leur enfance.
|
